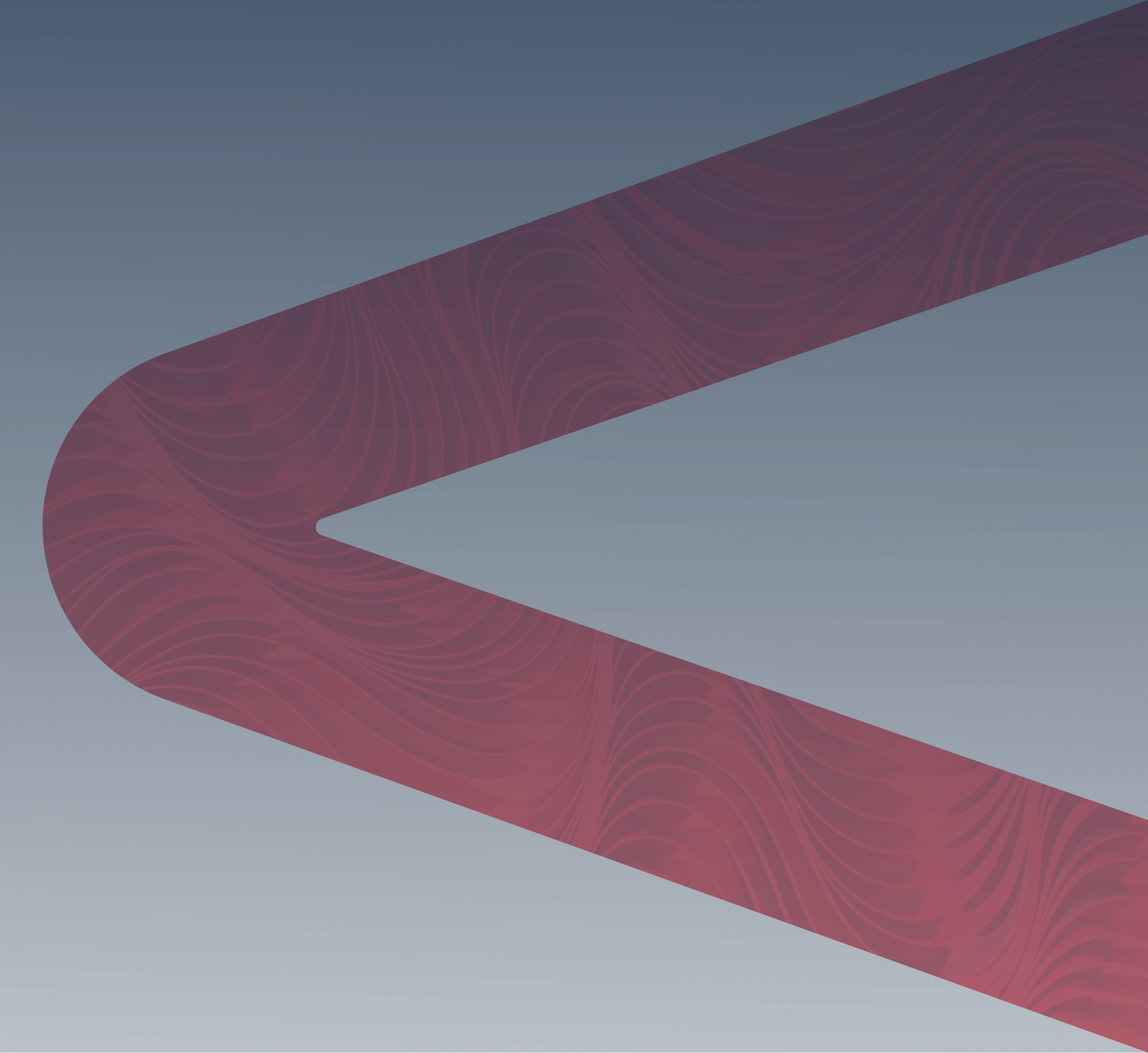Contrats publics
Le Conseil d’Etat précise le régime contentieux et les modalités de conclusion des conventions de projet urbain partenarial (PUP).
CE, 12 mai 2023, SCI MASSONEX n°464062
Dans un arrêt mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat précise qu’une convention de projet urbain partenarial (PUP) conclue sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans le cadre d’un recours de plein contentieux[1], dans les conditions posées par la jurisprudence Tarn-et-Garonne.
En outre, concernant la mise en œuvre du II de l’article L. 332-11-3 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat considère que même si les équipements publics prévus par une convention PUP sont susceptibles de desservir des terrains autres que les parcelles mentionnées dans ce premier contrat, ce dernier n’a pas à déterminer les modalités de partage des coûts des équipements, ni le périmètre à l’intérieur duquel d’autres conventions sont nécessaires.
Il en résulte qu’à supposer que les équipements partiellement financés par la société puissent desservir d’autres terrains que ceux mentionnés par la convention de projet urbain partenarial litigieuse, la circonstance que la communauté de communes n’ait pas, avant de la conclure délimité le périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires, aménageurs ou constructeurs se livrant à des opérations participeraient à la prise en charge des
équipements publics desservant plusieurs terrains est sans incidence sur la légalité de cetteconvention.
Cette décision du Conseil d’Etat confirme la pratique des collectivités en matière de projet urbain partenarial.
Renouvellement des organes dirigeants d’une collectivité publique et prescription de l’action quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles.
CE, 9 mai 2023, n°451710, Société Gespace France et autres, Rec. ; n°451817, Société Eiffage construction et Fougerolles et autres, Rec.
Dans plusieurs arrêts rendus le 9 mai 2023, le Conseil d’État a considéré que, s’agissant d’une action en responsabilité quasi-délictuelle intentée par une collectivité publique à l’encontre d’attributaires coupables de pratiques anticoncurrentielles, le délai de prescription ne court qu’à compter du moment où la collectivité a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part desdits attributaires.
Au surplus, dans le cas où les organes dirigeants de la collectivité ont participé à ces pratiques anticoncurrentielles – ce qui, en tout état de cause, fait obstacle à ce que cette dernière puisse faire valoir ses droits à réparation – « la prescription ne peut courir qu’à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de ces pratiques ».
Notons au passage que le Conseil d’État a rappelé qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, aux termes de l’article 2270-1 du Code civil. Depuis lors, le délai de prescription a été abaissé à cinq ans, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil puis, depuis l’ordonnance du 9 mars 2017, de l’article L. 482-1 du Code de commerce.
Urbanisme et environnement
Le Conseil d’Etat clarifie le pouvoir de sanction du préfet dans le cadre d’une non-conformité des conditions d’exploitation d’une ICPE.
CE, 10 mai 2023 SARL Lombricorse n°447189
Dans un arrêt mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat rappelle que le constat d’une non-conformité des conditions d’exploitation d’une ICPE par l’inspecteur des ICPE, doit être suivi d’une mise en demeure édictée par le préfet qui est en situation de compétence liée[2].
En l’espèce, le préfet avait mis en demeure la société exploitante de réaliser une étude de faisabilité technique et de réaliser les travaux, la mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet a prononcé la suspension de l’activité de l’installation concernée.
Le Conseil d’Etat rappelle que cette mise en demeure ne constitue pas une sanction, mais a pour objet, « en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation ».
En outre, en cas d’inexécution de l’injonction, l’article L. 171-8 du Code de l’environnement laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions, il « peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat conclut à l’absence de disproportion de la sanction justifiée par la méconnaissance des conditions d’exploitation, laquelle est à l’origine de nuisances olfactives significatives pour le voisinage portant atteinte à l’environnement et à la santé publique.
L’évolution d’une règle d’urbanisme ne vaut pas régularisation des autorisations d’urbanisme après un sursis à statuer.
CE 4 mai 2023, Société Octogone n° 464702
Dans un arrêt du 4 mai 2023, le Conseil d’Etat précise la mise en œuvre de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, applicable au contentieux de la régularisation des autorisations d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat précise que si le titulaire d’un permis de construire a été invité par le juge administratif à régulariser son autorisation à la suite d’un sursis à statuer et que cette modification n’a pas été réalisée dans le délai accordé, la seule circonstance que la règle méconnue ne soit plus applicable au jour où le juge statue, ne permet pas d’expier l’autorisation initiale de son irrégularité.
En effet, la modification de la règle d’urbanisme, qui fonde le sursis à statuer n’a aucune incidence sur la validité des autorisation antérieurement délivrées. Il en résulte que le pétionnaire doit solliciter auprès de l’autorité compétente la délivrance d’une nouvelle autorisation permettant d’acter la régularisation.
Appréciation du degré de contrariété entre un projet et le futur PLU permettant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire
TA Nice, 10 mai 2023, n° 1906159
Dans un jugement en date du 10 mai, le Tribunal administratif de Nice a été amené à se prononcer sur la question suivante : à partir de quel degré de contrariété entre un projet et le futur PLU l’administration peut-elle surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ?
Au cas d’espèce, le juge administratif a considéré qu’un écart de 80% entre la longueur projetée d’une façade et la limite imposée par le futur PLU « compromettait bien (…) l’exécution du futur plan local d’urbanisme », aux termes de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme.
On remarquera que si Nicolas Beyls, rapporteur public, avait conclu au rejet de la requête sur ce fondement, il avait également considéré, dans ses conclusions, qu’une emprise au sol représentant 20% de la superficie du terrain d’assiette ne mettait pas le projet en « contradiction flagrante » avec le futur PLU, lequel prévoyait une limite de 15%. C’estune solution similaire à celle retenue sur ce point par la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans une décision récente (CAA Bordeaux, 12 mai 2022, n°20BX02796).
[1] CAA de Nantes 23 juillet 2018 n°17NT00930
[2] CE 9 juillet 2007 n°288367, Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables c/ Société Terrena Poitou mentionné aux tables du Recueil Lebon.