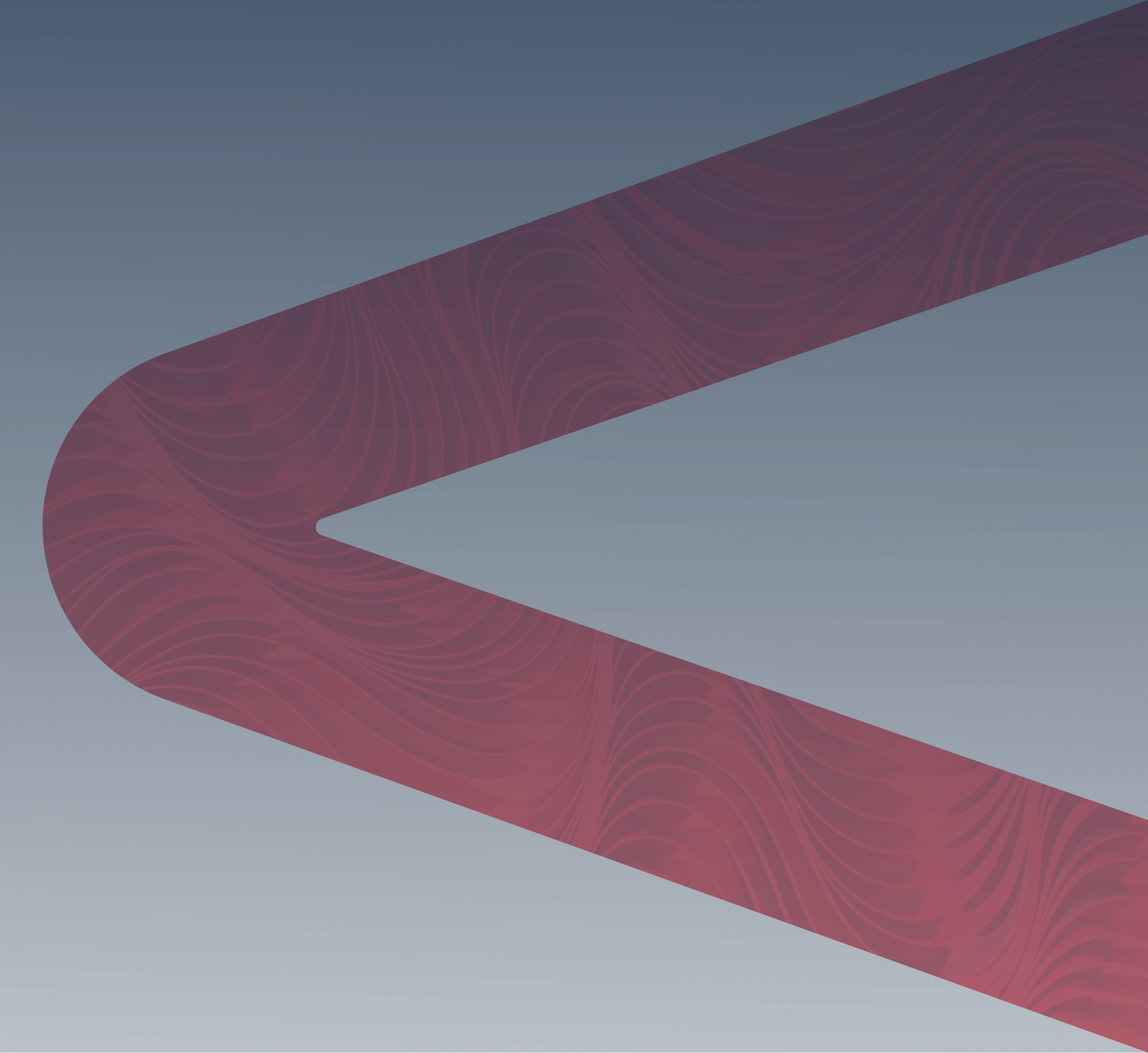Contrats publics
Conséquences et suites de l’incorporation dans le domaine public de parcelles grevées d’un bail rural
CE, 7 juin 2023, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, n° 447797, Rec.
Au cas d’espèce, un éleveur, titulaire d’un bail rural sur plusieurs parcelles, avait vu ces dernières incorporées dans le domaine public du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). Arguant que l’éleveur se trouvait dès lors dans une situation d’occupation sans titre du domaine public, le CELRL l’a déféré devant le Tribunal administratif de Marseille comme prévenu d’une contravention de grande voirie. Faisant droit aux demandes de l’établissement public, le Tribunal va condamner pécuniairement l’éleveur et l’enjoindre d’évacuer les lieux. Ce jugement va cependant être annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, lequel va être confirmé par le Conseil d’Etat.
En effet, l’éleveur n’était pas dépourvu d’un titre d’occupation ! Si, dès lors que les parcelles ont été incorporées dans le domaine public, le bail a perdu son caractère de bail rural puisque que comportant des clauses incompatibles avec la domanialité publique, il continue de constituer, jusqu’à une éventuelle dénonciation, un titre d’occupation valable du domaine public.
Cela étant dit, le Conseil d’Etat poursuit en exposant les éventuelles suites à donner.
En premier lieu, l’établissement public peut, avant l’expiration dudit bail, procéder à sa résiliation. Dès lors, le CELRL peut confier à l’ancien exploitant, ou, autrement, à un autre exploitant, une convention d’usage temporaire et spécifique, prévue à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, afin d’autoriser un usage des parcelles compatible avec les missions de sauvegarde et de préservation des sites naturels qui incombent à l’établissement public.
En second lieu, l’établissement public peut choisir de ne pas dénoncer le bail. Si la domanialité publique fait inéluctablement obstacle à ce que celui-ci soit renouvelé une fois arrivé à échéance, l’exploitant conservera, à titre précaire, un titre d’occupation procédant du bail initial.
Pas de régularisation obligatoire pour une erreur de processus entachant une candidature
CE, 1er juin 2023, CA de la Région de Château-Thierry, n° 469127, Rec. T.
Dans un arrêt mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat s’est intéressé à une problématique née de la dématérialisation des procédures de la commande publique et de la mise en place des profils d’acheteur : que doit faire le pouvoir adjudicateur lorsque le soumissionnaire s’est trompé de « tiroir numérique » et a déposé son offre ou candidature dans celui d’une autre consultation ?
C’est dans cette situation que s’est retrouvée la requérante de l’instance ayant aboutie à l’arrêt ici commenté. Sa candidature ayant été écartée par l’acheteur au motif qu’elle avait déposée dans le mauvais « tiroir numérique », elle a saisi le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif d’Amiens, lequel a annulé la procédure, considérant que les pièces de la candidature « ne pouvaient être manifestement regardées comme regardées comme présentées au titre d’une autre procédure », que corriger ce hiatus « ne nécessitait en l’espèce aucune analyse non plus qu’aucune contrainte particulière pour le pouvoir adjudicateur » et que, partant, une telle erreur de la société requérante ne pouvait dispenser ce dernier de prendre en compte sa candidature.
En somme, le Tribunal a considéré que rectifier l’erreur matérielle du candidat constituait une obligation pour l’acheteur, obligation à laquelle il ne pouvait se soustraire sous peine d’entacher d’illégalité la procédure de passation. Un raisonnement qui, à première vue, n’apparaissait pas totalement infondé : le Conseil d’Etat a déjà pu juger qu’un hiatus dans la transmission d’une pièce, exigée par l’acheteur à l’appui des offres mais transmise par erreur dans l’enveloppe relative aux candidatures, ne pouvait justifier à lui seul l’élimination de l’offre (CE, 7 novembre 2008, n° 292570). Une solution confirmée, s’agissant de certaines erreurs « purement matérielles », par un arrêt Département des Hauts de Seine (CE, 21 septembre 2021, n° 349149).
Pour autant, le Conseil d’Etat va annuler l’ordonnance du Tribunal administratif d’Amiens, considérant, d’une part, « qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public ».
Le juge administratif a ainsi écarté l’application de sa jurisprudence précitée. Comme l’explique le rapporteur public, Nicolas Labrune, dans ses conclusions sur cette affaire, il faut tempérer la portée de la décision Département des Hauts de Seine, qui ne devrait trouver à s’appliquer que lorsque l’erreur est une « aberration matérielle » telle qu’elle nécessitera obligatoirement une correction au cours de l’exécution du contrat.
Ainsi, pour des irrégularités « de forme ou de processus » prévaut le principe bien établi (v. CE, 26 mai 2009, n° 318871 ; CE, 21 mars 2018, n° 415929) selon lequel l’adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre, et n’est donc certainement pas tenu de la rectifier lui-même.
Offre jugée irrégulière et intérêt à agir du candidat évincé en référé précontractuel
CE, 1er juin 2023, Société Vinci Airports, n° 468930, Rec. T.
Dans un arrêt mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat a apporté une précision notable quant à l’appréciation de l’intérêt à agir en référé précontractuel des candidats évincés ayant soumis une offre jugée irrégulière.
En premier lieu, comme le rappelle la Haute juridiction administrative, il est de jurisprudence établie que « la circonstance que l’offre d’un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, pour contester l’attribution du contrat, de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire » (CE, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 435982).
Toutefois, la Haute juridiction administrative précise, dans le présent arrêt, que lorsque l’offre du candidat évincé a été jugée irrégulière et donc éliminée par une décision juridictionnelle devenue définitive, alors ce dernier n’a plus intérêt à agir contre la nouvelle décision portant attribution du contrat après reprise de la procédure annulée par ladite décision juridictionnelle.
Comme l’explique Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public, dans ses conclusions sur la présente affaire, cette solution s’inscrit en cohérence avec les principes dégagés par la jurisprudence communautaire. La CJUE avait ainsi jugé que lorsque l’exclusion d’un candidat avait été confirmée par une décision juridictionnelle ayant acquis l’autorité de la chose jugée, le candidat évincé « devait être considéré comme étant définitivement exclu de la procédure de passation du marché public en cause » (CJUE, 11 mai 2017, aff. C-131/16).
Dès lors, et en tout état de cause, un tel candidat ne peut plus être regardé comme ayant intérêt à conclure le contrat, au sens des articles L. 551-10 ou L. 551-24 du code de justice administrative.
Urbanisme et environnement
Opposabilité d’un cahier de recommandations architecturales et précisions sur la suppression temporaire de l’appel en zone tendue
CE, 2 juin 2023, SCI du 90-94 avenue de la République, n° 461645, Rec.
Dans un arrêt publié au recueil, la Haute juridiction administrative a apporté d’importantes précisions sur, d’une part, le champ d’application de la suppression temporaire de l’appel en zone tendue et, d’autre part, la portée et l’opposabilité d’un cahier de recommandations architecturales.
Se posait d’abord la question de la compétence du Conseil d’Etat. En effet, et pour rappel, l’article R. 811-1-1, 1° du code de justice administrative dispose que les jugements des tribunaux administratifs portant sur le refus ou l’octroi autorisations d’urbanisme ayant pour objet soit la construction ou la démolition d’un bâtiment à usage principal d’habitation comportant plus de deux logements, soit l’aménagement d’un lotissement, sont rendus « en premier et en dernier ressort » dès lors que le projet est implanté sur le territoire d’une commune située en zone tendue. Cela permet de réduire des délais de jugement susceptibles de compromettre ou retarder la réalisation d’opération de constructions de logements. Pour les parties, il en résulte que seul un pourvoi au Conseil d’Etat peut être formé à l’encontre du jugement de première instance.
En l’espèce, l’autorisation en litige était un permis de construire projetant la surélévation d’une construction existante et, subséquemment, l’aménagement de huit logements. En se reconnaissant compétent pour connaître le pourvoi formé par le pétitionnaire contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles annulant le permis, le Conseil d’Etat admet que l’exception prévue à l’article R. 811-1-1, 1° du code précité s’applique également aux permis de construire autorisant des travaux sur des constructions existantes, à condition « d’une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d’autre part, que ces travaux aient un usage principal d’habitation, c’est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l’habitation », comme c’était le cas en l’espèce.
La Haute juridiction administrative s’est ensuite prononcée sur le fond, c’est-à-dire sur la question de savoir si le permis en litige pouvait être annulé sur le fondement de dispositions contenues dans un cahier de recommandations architecturales.
Si, dans un premier temps, le Conseil d’Etat reconnaît que rien, dans les dispositions du code de l’urbanisme, n’interdit à un PLU de renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales », il précise que celui-ci n’est opposable « que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement ».
Au cas d’espèce, l’article 11 du PLU renvoyait directement à un cahier de recommandations architecturales pensé comme étant « un guide pédagogique qui porte des recommandations techniques en complément du règlement » visant à « expliciter et à prolonger les prescriptions du règlement ». Par ailleurs, il était clairement indiqué, dans ce même article 11, qu’en cas de doute sur l’application d’une disposition, c’est le règlement qui doit prévaloir. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que ledit cahier était opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
Sur ce point, cette décision du Conseil d’Etat est à rapprocher d’un récent jugement du Tribunal administratif de Rouen (26 janvier 2023, n° 2202586), lequel avait annulé une délibération approuvant une charte de l’urbanisme et du cadre de vie qui imposait des règles impératives aux opérateurs immobiliers.
Notons, en dernier lieu, que le Conseil d’Etat a partiellement annulé le jugement de première instance, en ce qu’il avait admis la possibilité, pour l’administration, de « subordonner la mise en œuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un avis préalable de la commune », et ce alors même qu’il ne lui appartenait pas « d’imposer des formalités non prévues par le code de l’urbanisme pour la mise en œuvre de l’autorisation délivrée ».
Pour les collectivités, l’enseignement à inférer de ces deux derniers points est le suivant : si elles peuvent parfaire leur politique d’urbanisme avec des éléments non-prévus par le code, à l’instar de chartes, cahiers ou autres documents de soft law, elles ne peuvent pas pour autant excéder les limites de leur compétence, en créant des normes et formalités plus contraignantes que l’existant régulièrement établi ou en contradiction avec celui-ci.
Précisions sur les règles d’urbanisation en continuité
CE, 12 juin 2023, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, n° 466725, Rec. T.
CE, 12 juin 2023, Sté Bouygues Immobilier, n° 459918, Rec. T.
Dans deux arrêts rendus le 12 juin 2023 sur deux affaires différentes, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les règles d’urbanisation en continuité s’appliquant dans les zones soumises aux régimes contraignants de la Loi Montagne et de la Loi Littoral.
D’une part, et dans l’arrêt n° 466725, la Haute juridiction administrative a considéré que, dès lors que le projet en litige autorise plusieurs annexes aux constructions existantes, exceptions à la règle d’urbanisation en continuité énoncée à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, leur caractère limité doit s’apprécier de manière globale. Il a ainsi été jugé que la Cour administrative d’appel de Lyon avait commis une erreur de droit en se bornant à apprécier, annexe par annexe, leur taille limitée et leur ampleur au regard de l’existant, alors que son analyse aurait dû porter sur l’ensemble formé par les annexes projetées.
D’autre part, et dans l’arrêt n° 459918, le Conseil d’État, tranchant cette fois-ci un litige relatif à la Loi Littoral, a jugé qu’un immeuble construit à côté d’un lotissement peut s’inscrire en continuité de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code précité, dès lors que ce lotissement présente les caractéristiques, en termes de nombre et de densité des constructions, d’une agglomération ou d’un village. En effet, et comme l’a formellement arrêté le juge administratif, « la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création d’un secteur est sans incidence pour apprécier s’il caractérise une agglomération ou un village existant ».
Conséquences de l’entrée en vigueur de nouvelles règles d’urbanisme sur l’utilisation d’un terrain et opposabilité des droits acquis
CE, 2 juin 2023, Commune de Saint-Laurent-du-Var, n° 449820, Rec. T.
Dans un arrêt mentionné aux Tables en date du 2 juin 2023, le Conseil d’Etat a été amené à aborder une nouvelle fois l’épineuse question des conséquences de l’entrée en vigueur de nouvelles règles d’urbanisme sur les droits acquis par un permis de construire antérieur à ces dernières.
En l’occurrence, la requérante est propriétaire d’un immeuble et d’un terrain sur lesquels elle avait consenti un bail commercial au profit de la société automobile de Provence. A la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau plan local d’urbanisme en 2013, la municipalité a adressé un courrier à ladite société, lui signifiant que son utilisation du terrain, dorénavant situé dans une zone agricole, n’était pas conforme au règlement. Par suite, la société a résilié son bail, et la requérante a saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir réparation du préjudice entraîné par le courrier du maire.
Pour fonder sa demande, la requérante se prévaut des droits acquis par un permis de construire délivré le 17 aout 1959 pour le terrain dont il est question. En effet, il est constant qu’il découle d’une telle autorisation « des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d’un plan local d’urbanisme entrées en vigueur postérieure à sa date de délivrance ».
Cependant, et comme l’a relevé la Haute juridiction administrative, le permis de construire versé au dossier « autorisait seulement la construction d’un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, un atelier, des bureaux, et des vestiaires-lavabos et, au premier étage, deux appartements ».
Partant, et dès lors que la société automobile de Provence se servait du terrain comme parking pour sa flotte d’autobus et de véhicules dans le cadre de son activité commerciale – soit un usage étranger aux droits acquis par le permis initial – le maire, en indiquant à cette dernière qu’un tel usage était contraire aux dispositions du nouveau PLU, n’a ni méconnu les droits de la requérante, ni commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Caractérisation d’une opération d’aménagement par le juge administratif
CE, 30 juin 2023, n° 468543, Sté MJ développement immobilier, Rec. T.
Saisi d’un pourvoi formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux, le Conseil d’Etat a rappelé les caractéristiques permettant d’identifier une opération d’aménagement.
Pour rappel, il est constant que, pour mettre en œuvre une zone d’aménagement concerté, il convient au préalable de vérifier « si les opérations projetées répondent à la définition des opérations d’aménagement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme » (CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC02426).
Cela vaut également pour l’exercice du droit de préemption, aux termes de l’article L. 210-1 du code précité. Dans ce cadre, la Haute juridiction administrative nous dit ici qu’il n’est pas nécessaire que les caractéristiques du projet aient été précisément arrêtées pour faire usage du droit de préemption : il est simplement attendu de la collectivité qu’elle justifie de la réalité d’un projet d’opération d’aménagement et qu’elle en fasse apparaître la nature dans la décision de préemption.
S’agissant plus spécifiquement de la caractérisation d’une opération d’aménagement, rappelons que l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme a retenu une approche finaliste. Dès lors, le Conseil d’Etat considère qu’est une opération d’aménagement le projet qui répond à un des objectifs fixés par le texte comme, par exemple, et au cas d’espèce, la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat.
Le juge, par ailleurs, prend en compte la complexité, c’est-à-dire l’ampleur et la consistance de l’opération. Cependant, au regard de la jurisprudence récente, la portée de ce critère est à relativiser : on a ainsi pu voir qualifiée d’opération d’aménagement la construction de quelques dizaines de logements locatifs sociaux (CE, 2 novembre 2015, n° 374957 ; CE, 19 décembre 2019, n° 420227). De la même manière, au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la construction d’une quarantaine de logements, dont la moitié à caractère social, constituait une opération d’aménagement.
/